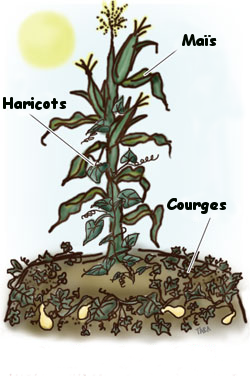Chapitre III
Permaculture
et agro écologie
J’ai grandi dans l’idée de changer le système, je ne vais pas m’en cacher. » Diplômée en science et gestion de l’environnement (ainsi qu’en analyse et en écriture cinématographique), Valérie De Munter était à Hong Kong pour « créer un réseau » ; pour « parler d’une seule voix ».
« Pour nos grands-parents, c’était important d’effectuer de grandes études pour bénéficier d’une situation professionnelle, poursuit Valérie De Munter. C’était ça le progrès. Ils ont vécu dans un système de plein emploi où gagner de l’argent permettait de combler les besoins d’après-guerre. »
Citadine issue « d’un milieu privilégié », la jeune femme a fréquenté des établissements scolaires « rigides et élitistes » où « les maths et la physique primaient sur tout le reste ». Son intérêt pour « la nature », dit-elle, nait d’ailleurs d’une absence.
« Voir un renard, pour moi, c’était déjà quelque chose d’exceptionnel. Les animaux, les forêts,… C’était presque exotique. La Belgique, c’est pas vraiment un pays où tu peux voir des orques à la mer du Nord. »

Sensibilisée aux dimensions politique, sociale, économique de l’environnement, Valérie De Munter découvre - en partie - l’agriculture urbaine au Canada, où elle participe à un programme d’échange universitaire.
« Il y a 5 ans, en Belgique, c’était un domaine moins facile d’accès. C’était un peu réservé à un public d’initiés. Mais à Montréal, ça faisait déjà partie des habitudes des habitants. Tout le monde cultive son petit potager dans son jardin. C’est très convivial. Ils parviennent à maximiser l’espace pour créer de véritables jungles de fruits et de légumes. A l’UQAm (Université du Québec à Montréal, NdlR.), il y a des professeurs comme Eric Duchemin qui ont lancé des projets intégrant les bacs potagers, des ruches, etc. Des gens parlaient de ça, de lier toutes ces problématiques sur lesquelles on se questionnait. »Six mois plus tard, Valérie De Munter revient en Belgique mais ne retrouve pas la même « énergie ».
« A Montréal, ça bougeait et ici, plus rien. Tout le monde cherchait du boulot mais personne n’en trouvait. C’était déprimant. Quand t’as 26 ans, que tu t’inscris chez Actiris, que tu te rends compte que le service environnement est relégué dans la sous-sous-sous catégorie « service et nettoyage » et qu’on te redirige vers l’insémination de vaches parce que t’as un Master en environnement, tu te dis qu’on n’est pas gâté. J’appartiens quand même à une couche de la société qui a eu de la chance au niveau social. Je n’ai pas grandi dans le besoin. Mes parents étaient des gens ouverts. Et si moi, j’ai du mal à me retrouver dans cette société alors que j’ai plus de cartes en main, qu’en est-il des autres ? Il y a un vrai problème. Il n’y a aucun projet, aucune valeur à transmettre, aucunes perspectives.»« Partir », s’impose. Mais où ? Et pour « quoi faire »? Thaïlande, Laos, Birmanie, Vietnam, France, … Deux années durant, Valérie De Munter voyage de fermes en fermes, travaille « contre le gîte et le couvert », expérimente de nouvelles techniques, apprend. « C’est là que je me suis vraiment familiarisée avec la permaculture et l’agro écologie. »
La France – ou la Belgique - offre des formations mais « elles sont peu pratiques, très théoriques ».« Ici, tu payes souvent 1000 euros pour rester cinq jours dans une classe. Tu payes, tu payes, tu payes, c’est un peu Disney quoi. »
La jeune femme veut en effet dépasser « le truc de bobo » : produire et vivre de la permaculture, développer des projets à la fois viables et durables. « L’objectif, c’est pas de devenir des hippies ou des baba cool mais de développer un système pérenne et qui suffise à nourrir les populations. On n’est pas là pour gagner des millions sur le dos de la sécurité alimentaire mais les agriculteurs doivent pouvoir en vivre. »

Après s’être rendue dans l’Oasis de Pierre Rabhi en Bretagne, Valérie De Munter rentre en Belgique, tente d’accéder à la propriété, recherche une terre agricole. En vain. « A cause de la pression foncière c’est devenu impossible d’acheter en Belgique. La France, pour ça, est beaucoup moins cher. Ici, pour avoir un terrain et cultiver, t’en as pour 300000 euros minimum. Je caricature mais un hectare de terre en Belgique c'est minimum 25000 euros. Or t’as pas des revenus confortables quand tu commences. Alors j’ai continué à apprendre et à bosser dans mon jardin. J’ai expérimenté de nouvelles techniques. »
D’où la permaculture en ville, en bac ou en pleine terre. « A la campagne, les agriculteurs sont encore dans le conventionnel. Mais les gens ont un potager. Ils ont souvent des poules. Ils n’ont pas perdu ce lien avec la nature. C’est en ville qu’il y a un malaise. Nous faisons partie d’une génération qui cherche du sens. On est coupés de tout. Je ne sais même plus où sont produits toutes ces choses que je touche : cette tasse, ce meuble, cette chaise sur laquelle je suis assise. D’où ça vient ? Comment c’est fabriqué ? Par qui ? Avec quel impact sur les autres ? Sur le monde qui m’entoure ? Quelques personnes détruisent la planète qui m’appartient autant qu’à eux. Or moi je n’ai pas envie que le rhino disparaisse mais je n’ai pas le choix. Personne ne m’entend, je pourrais manifester là, tout de suite, toute seule, les gens vont me filmer et mettre la vidéo sur Youtube pour se foutre de ma gueule. Ça, c’est le monde dans lequel on vit ! On ne nous écoute plus. Tout nous échappe. Apporter un peu de sens à tout ça me paraît essentiel. »

Valérie De Munter, qui appréhende les enjeux environnementaux dans une vision globale et systémique, a lancé sa propre asbl (« Les jardins comestible »). Elle conçoit, installe et entretient des bacs en bois, en géotextile et en pleine terre selon les techniques issues de l’agro écologie et de la permaculture. « Mais pour que ce genre d’activités puisse vraiment se développer à Bruxelles, il faudrait que les pouvoirs publics suivent mais ils ne le feront jamais parce que les intérêts économiques, avec la Chine, le Canada et les USA notamment, sont beaucoup trop importants. Ils préfèrent mettre de l’argent là-dedans. Le Ceta (l'accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada, NdlR), c’est peut-être très bien pour des tas de choses, mais pour les agriculteurs, c’est catastrophique. Or il s’agit de ce que nous mangeons ! C’est une question de sécurité alimentaire, de santé publique, d’emplois, de durable, d’environnement. On dit qu’on soutient l’agriculture urbaine ou péri-urbaine, et en même temps on autorise les importations canadiennes à prix discount. Faut arrêter ! Il y a un problème. C’est hypocrite. Oui, on donne des subsides avec la stratégie « Good Food » (mis en place par Bruxelles Environnement, NdlR) mais personne d’autre qu’eux ne soutient cette politique puisque, à côté, on n'empêche cette politique de véritablement se développer. Toutes les initiatives qu’on met en place, au final, c’est plus de la sensibilisation et de l’éducation. On doit dépasser tout ça, inventer de nouveaux modèles. C’est aux pouvoirs publics d’être enfin cohérents. »